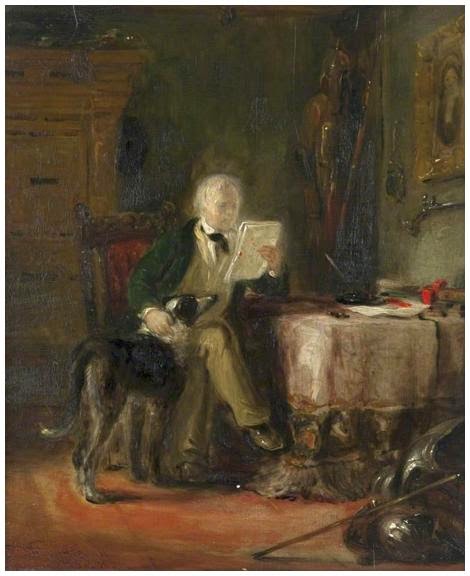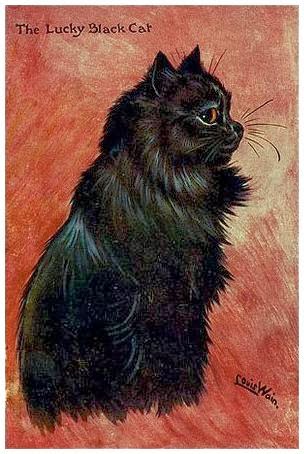...
Non la terre ne se saoule pas
la terre ne tourne pas de travers
elle pousse régulièrement sa petite voiture des quatre saisons
la pluie... la neige...
la grêle... le beau temps...
jamais elle n’est ivre
c’est à peine si elle se permet de temps en temps
un malheureux petit volcan
la terre ne tourne pas de travers
elle pousse régulièrement sa petite voiture des quatre saisons
la pluie... la neige...
la grêle... le beau temps...
jamais elle n’est ivre
c’est à peine si elle se permet de temps en temps
un malheureux petit volcan
Jacques Prévert
Étymologiquement, la pyrotechnie est l'Art du Feu. La pyrotechnie est la science étudiant la combustion des matériaux sans intervention de l'oxygène de l'air. D'où, une certaine analogie entre la formation du magma qui s'échappe desvolcans et la pyrotechnie des feux d'artifice.
Dans le cas des volcans, c'est principalement l'incandescence de la lave qui produit les effets lumineux.
Dans le cas des volcans, c'est principalement l'incandescence de la lave qui produit les effets lumineux.
 |
| Éruption du Vésuve (détail) Pietro Fabris - 1771 planche XXXVIII du Campi Phlegraei |
Au fil du temps, les volcans sont devenus une attraction spectaculaire pour les populations qui avaient la chance de se trouver à bonne distance de leurs éruptions pour ne pas en être victimes.
 |
| Vue de l'éruption du Mont Vésuve Pierre-Jacques Volaire - 1779 huile sur toile 56 x 76 cm, collection privée |
 |
| Feux d'artifice au Château Saint-Ange à Rome Jakob Philipp Hackert - 1775 Klassik Stiftung, Weimar |
Après que Pline le Jeune a été le témoin et rapporteur de l'éruption explosive de 79 qui a enseveli (entre autres) la ville de Pompéi, le Vésuve n'a pour ainsi dire jamais cessé d'être un objet d'étude pour les érudits.
 |
| La destruction de Pompéi Pierre-Henri de Valenciennes - dernier quart du XVIIIe siècle collection privée |
Après Pline le Jeune, les volcans ont continué à exciter la curiosité des hommes. À partir du XVIIe siècle les savants échafaudèrent théories sur théories pour tenter de déterminer leur origine et leur formation. L'un des premiers à s'aventurer sur le terrain fut un anglais, Sir William Hamilton, ambassadeur britannique au royaume de Naples entre 1764 et 1800.
Durant son mandat, lord William Hamilton, a très souvent gravi les pentes du Vésuve pour observer ce volcan de près.
 |
| Éruption du Vésuve (étude pour Campi Phlegraei) Pietro Fabris - 1771 Museo Nazionale di San Martino, Naples |
Lors de l'éruption effusive du 11 mai 1771, Hamilton accompagné du peintre Piétro Fabris (employé pour faire des croquis destinés à illustrer le livre de l'ambassadeur) furent les guides de Ferdinand 1er et Marie-Caroline d'Autriche, le couple royal de Naples et de Sicile, ainsi que des courtisans qui s'aventurèrent sur les pentes du volcan afin de contempler le fantastique spectacle offert par la nature en furie.
 |
| Le roi et la reine de Naples visitant les lieux de l'éruption de 1771 avec sir William Hamilton Pietro Fabris - 1771 Campi Phlegraei ou Observations sur les volcans des Deux Siciles, Naples, 1776-1779, planche XXXVIII |
Avant l'avènement de la photographie en couleurs, ce sont les peintres qui ont immortalisé les grands spectacles pyrotechniques offert par le Vésuve, jamais avare d'attraction sensationnelles... et par les princes, toujours avides de gloire.
 |
| Éruption du Vésuve Camillo de Vito (gouache) collection privée (lire la notice) |
 |
| Feu d'artifice au Château Saint-Ange à Rome Pietro Fabris - vers 1773 Government Art Collection, UK |
 |
| L'éruption du Vésuve en 1774 Jakob Philipp Hackert - 1774 Staatliche Kunstsammlungen, Dresden |
 |
| Feu d'artifice à Torre Annunziata Oswald Achenbach - vers 1863-72 Palais Dorotheum, Vienne |
 |
| L'éruption du Mont Vésuve Pierre Jacques Volaire - 1777 North Carolina Museum of Art |
 |
| Festival et feu d'artifice au clair de lune à Resina Oswald Achenbach - 1855 Crocker Art Museum, Sacramento USA |
 |
| L'éruption du Vésuve de 1779 Jakob Philipp Hackert - 1779 collection privée (notice) |
 |
| Feu d'artifice à Naples Oswald Achenbach - 1875 Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg (notice) |
 |
| Éruption du Vésuve Camillo de Vito - 1817 collection privée |
 |
| Éruption du Vésuve (gouache) École napolitaine - vers 1830 collection privée |
Pour terminer, ce billet explosif, voici un aperçu de spectacles pyrotechniques sans artifices, mais non dénués d'émotions fortes :
Bonne fête nationale !
et
beau feu d'artifice
(si c'est le 14 dans votre commune)
(si c'est le 14 dans votre commune)
©VesperTilia, échos-de-mon-grenier 2013